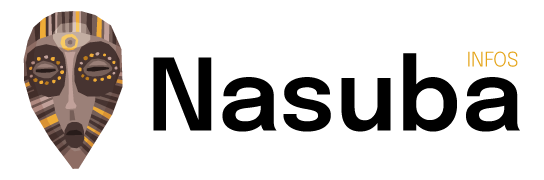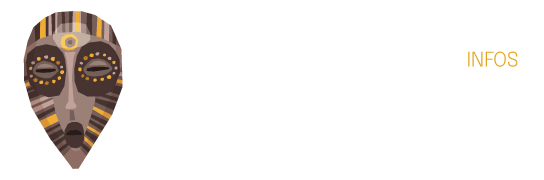Le 21 avril 2025, le monde a perdu l’un de ses plus grands leaders spirituels et moraux : le pape François. À l’âge de 88 ans, Jorge Mario Bergoglio, le premier pape jésuite, le premier pape latino-américain et le premier pape non-européen depuis plus de mille ans, a laissé une empreinte indélébile sur l’Église catholique et sur le monde.
Son pontificat, entamé en 2013, restera l’un des plus marquants de l’histoire moderne. Mais au-delà des titres, des symboles et des grands discours, c’est un homme d’action, de compassion et de vision qui a su faire résonner son appel à la paix, à la fraternité et à une Église plus proche des plus vulnérables.
Né en Argentine, un pays marqué par l’histoire tumultueuse de l’Amérique latine, François a grandi dans une réalité de lutte, d’inégalités et de fractures sociales. Ces premières expériences ont façonné sa vision du monde et de l’Église. En tant qu’archevêque de Buenos Aires, puis en tant que cardinal, il n’a cessé de prôner une Église pauvre pour les pauvres, une Église tournée vers ceux qui sont laissés pour compte par la société. Ce message, qu’il a porté avec audace dès ses premières interventions en tant que pape, a redéfini la manière dont le Vatican et l’Église catholique s’engagent sur la scène internationale.
Dès son élection, il a rompu avec les traditions papales pour incarner une simplicité et une humilité radicales. Il a rejeté les symboles du pouvoir religieux tels que la luxueuse résidence papale, pour opter pour une plus grande proximité avec les fidèles. Mais sa réforme la plus profonde a été celle de la gouvernance de l’Église elle-même : en mettant en place des réformes pour rendre la curie plus transparente, en plaidant pour une plus grande place des femmes et des jeunes dans les prises de décisions, en appelant à un dialogue sans fin sur des sujets sensibles tels que l’avortement, le mariage et la communion pour les divorcés, il a fait face à de nombreuses résistances. Pourtant, il a persévéré, avec cette conviction que l’Église doit être un lieu de miséricorde, et non un espace d’exclusion.
Le voyage, pour François, n’a pas été une simple expérience de déplacement, mais un acte de solidarité profonde. Ses déplacements dans des régions en proie à la guerre, à la pauvreté et aux conflits interreligieux, comme en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie, ont témoigné de sa volonté de bâtir des ponts, de favoriser la réconciliation et d’œuvrer pour une paix durable.
Son message à la République Démocratique du Congo, où il a dénoncé l’exploitation économique du continent africain, et son appel pour la justice et la paix au Soudan du Sud sont des moments marquants de ce pontificat. François a su utiliser son pouvoir symbolique pour attirer l’attention du monde sur les injustices oubliées et les souffrances des plus marginalisés.
Mais son plus grand héritage est probablement d’avoir inscrit l’Église dans les débats contemporains autour du changement climatique, de la pauvreté et de la justice sociale. À travers son encyclique Laudato Si’, il a mis en lumière les défis écologiques du XXIe siècle, appelant les nations à prendre des mesures audacieuses pour sauver notre planète. Son message est clair : il ne peut y avoir de justice sociale sans justice environnementale. Dans un monde déchiré par des inégalités croissantes, il a élevé la voix des sans-voix, du climat à la politique.
Le pape François a également marqué l’Église par sa volonté de renforcer le dialogue interreligieux et œcuménique. Son engagement envers les musulmans, les juifs et les autres communautés religieuses n’a cessé de croître. À travers des gestes symboliques forts, tels que son voyage en Égypte et sa rencontre avec le patriarche Bartholomée I à Istanbul, il a cherché à bâtir des ponts de fraternité, mettant en avant le respect mutuel au-dessus des divisions religieuses.
Aujourd’hui, alors que nous pleurons sa perte, nous devons aussi nous rappeler des défis auxquels il a fait face, des résistances qu’il a rencontrées, mais surtout de la vision qu’il nous a léguée. Un monde plus juste, plus inclusif, plus solidaire, où l’Église, mais aussi chaque citoyen, se doit d’être le bâtisseur de ponts plutôt que celui des murs. Son appel à la conversion n’était pas seulement spirituel, mais profondément social et politique.
Le décès du pape François ouvre un chapitre incertain pour l’Église catholique. Son héritage, cependant, est un modèle de ce que pourrait être une Église du XXIe siècle : une Église d’espérance, tournée vers l’avenir, attentive à l’écologie, à la justice sociale, et prête à se réformer pour incarner la miséricorde et la paix. Le défi sera désormais de savoir si son successeur saura poursuivre cette mission et répondre aux attentes d’un monde en pleine mutation.
Alors que nous regardons en arrière et que nous réfléchissons à ce qu’a été son pontificat, nous pouvons nous poser une question essentielle : avons-nous été à la hauteur de son appel ? C’est à nous, fidèles et citoyens du monde, de poursuivre cette œuvre de transformation.
Le pape François ne nous laisse pas seulement un héritage théologique, mais un véritable projet de société. Un projet qui invite chaque individu, chaque nation, à répondre à l’appel de l’amour, de la justice et de la paix. Un héritage que nous devons porter ensemble, en mémoire et en action.
Le comité éditorial
Suivez-nous sur Nasuba Infos via notre canal WhatsApp. Cliquez ici.
Views: 0