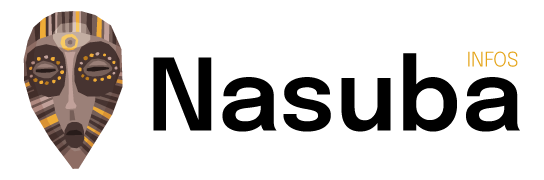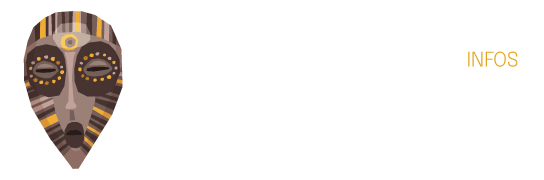Dans les démocraties occidentales, les partis politiques s’affrontent dans un jeu électoral balisé, où la majorité gouverne et la minorité critique. Un équilibre supposé garantir la pluralité et la transparence. Pourtant, lorsqu’il s’agit de l’Afrique, ce schéma est travesti. Le mot « opposition », qui se veut un pilier démocratique en Occident, devient en Afrique un outil de manipulation.
Une terminologie à géométrie variable
En France, aux États-Unis ou en Allemagne, les partis hors du pouvoir ne sont pas désignés comme une « opposition » au sens conflictuel du terme. On parle d’« alternative », de « forces de proposition », de « contre-pouvoirs ». La légitimité du jeu politique leur est acquise. Mais dès qu’il est question des États africains, le lexique change : on ne parle plus de forces alternatives, mais d’« opposition », un terme qui suggère un affrontement radical contre un pouvoir perçu comme forcément autoritaire.
Pire, les partis africains qui soutiennent les gouvernements en place sont eux-mêmes délégitimés sous l’étiquette de « partis du pouvoir », comme s’ils étaient foncièrement illégitimes. Une dichotomie qui ne s’applique jamais aux démocraties occidentales, où les partis au gouvernement ne sont pas désignés comme des entités suspectes mais comme des institutions légitimes du jeu électoral.
Une fabrication idéologique
Cette distinction n’a rien d’anodin. Elle relève d’un cadre idéologique forgé par l’Occident pour maintenir un contrôle discursif et politique sur les nations africaines. En créant une opposition perçue comme systématiquement persécutée, les puissances occidentales s’octroient le rôle d’arbitres de la démocratie en Afrique. Elles décident qui mérite d’être soutenu et qui doit être sanctionné.
Les ONG, les médias et les chancelleries européennes et américaines appuient cette rhétorique : tout régime africain qui ne s’aligne pas sur les intérêts occidentaux est accusé d’écraser son « opposition », tandis que ceux qui collaborent activement avec les puissances étrangères peuvent réprimer sans crainte.
La récente vague de sanctions contre des États comme le Mali ou le Niger illustre cette hypocrisie. Les régimes militaires y sont dénoncés pour leur répression de l’« opposition », alors même que des États alliés de l’Occident, aux pratiques similaires, ne font l’objet d’aucune pression.
Une instrumentalisation aux effets dévastateurs
Cette construction occidentale de l’« opposition » africaine a un double effet pervers. D’une part, elle alimente l’instabilité en encourageant des acteurs politiques à se poser en victimes pour obtenir un soutien extérieur. D’autre part, elle fragilise les États africains en imposant une grille d’analyse qui empêche une véritable consolidation démocratique fondée sur des dynamiques locales.
Loin d’être un simple détail sémantique, cette manipulation linguistique façonne la perception de la politique africaine à l’international. Il est temps de déconstruire ces narratifs et de permettre aux États africains de définir leurs propres modèles politiques, sans subir la tutelle d’un vocabulaire conçu pour les maintenir sous influence.
Suivez-nous sur Nasuba Infos via notre canal WhatsApp. Cliquez ici.
Views: 626