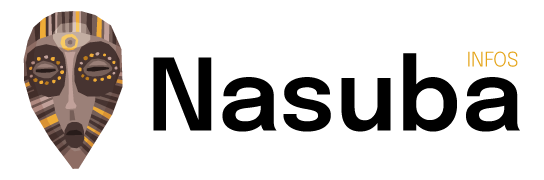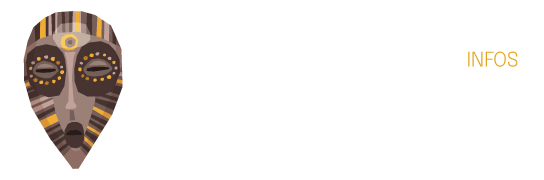Dans le cadre de l’affaire Boko, la Cour constitutionnelle s’est récemment prononcée sur deux exceptions d’inconstitutionnalité soulevées par les avocats de la défense. Ces décisions renforcent la jurisprudence en matière d’exception d’inconstitutionnalité et mettent en lumière des stratégies procédurales de la défense qui soulèvent des interrogations.
Première exception : le refus de remise de cause
Le 28 novembre 2024, les avocats des inculpés ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester une décision de la section de l’instruction en appel. Cette dernière avait refusé d’accorder une remise de cause, décision qualifiée par la défense de contraire à la Constitution.
Cependant, la Cour constitutionnelle a déclaré cette exception irrecevable, rappelant un principe fondamental : une exception d’inconstitutionnalité vise une disposition législative ou réglementaire, et non une décision individuelle rendue par une juridiction. En l’espèce, le refus de remise de cause constitue un acte juridictionnel et ne peut, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.
De plus, la Cour a relevé une contradiction dans la démarche des avocats, qui avaient eux-mêmes saisi cette juridiction d’instruction en appel pour demander l’annulation de la procédure contre leurs clients. Cette stratégie, jugée incohérente, a sans doute contribué à l’irrecevabilité de leur demande.
Deuxième exception : la procédure écrite devant la juridiction d’appel
Le 11 décembre 2024, les avocats ont présenté une deuxième exception d’inconstitutionnalité, cette fois contre l’article 12 du Code de procédure pénale. Cet article institue une procédure écrite pour l’examen des appels contre les ordonnances rendues par le juge d’instruction. Selon la défense, cette disposition serait contraire à la Constitution.
Là encore, la Cour constitutionnelle a rejeté l’exception. Elle a rappelé que la procédure écrite n’est pas, en soi, contraire aux principes constitutionnels dès lors qu’elle respecte les droits de la défense et les garanties d’un procès équitable.
La Cour a également noté que la saisine semblait être une tentative d’entraver le déroulement de la procédure. Les avocats avaient en effet relevé appel contre la décision de la commission d’instruction de la CRIET de ne pas ordonner des mesures d’instruction complémentaires, avant de saisir précipitamment la Cour constitutionnelle dans le but d’empêcher la juridiction d’appel de statuer.
LIRE AUSSI : Affaire Olivier Boko et Oswald Homéky : Mandat d’arrêt international contre Rock Nieri, beau-frère d’Olivier Boko
Analyse des motivations : un objectif dilatoire ?
Ces exceptions d’inconstitutionnalité, bien que permises par la loi, semblent avoir été utilisées comme un levier stratégique pour ralentir le cours de la procédure judiciaire. En multipliant les recours, les avocats espéraient manifestement gagner du temps ou créer un climat de doute autour de la régularité des procédures engagées.
Cependant, ces démarches n’ont pas résisté à l’examen rigoureux de la Cour constitutionnelle, qui a rappelé l’importance de ne pas instrumentaliser les mécanismes juridiques à des fins dilatoires.
Conséquences pour la suite de l’affaire
Les rejets successifs des exceptions d’inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle confirment la solidité des procédures suivies par la CRIET. En outre, ces décisions renforcent la jurisprudence sur les critères d’irrecevabilité des exceptions d’inconstitutionnalité, en mettant en avant l’importance de respecter le cadre légal et les principes fondamentaux de ce mécanisme.
Pour les inculpés et leurs avocats, ces revers judiciaires limitent désormais leurs marges de manœuvre procédurale. Quant à l’opinion publique, elle demeure attentive à l’évolution de cette affaire, où s’affrontent stratégie judiciaire et impératifs de justice.
Views: 2484